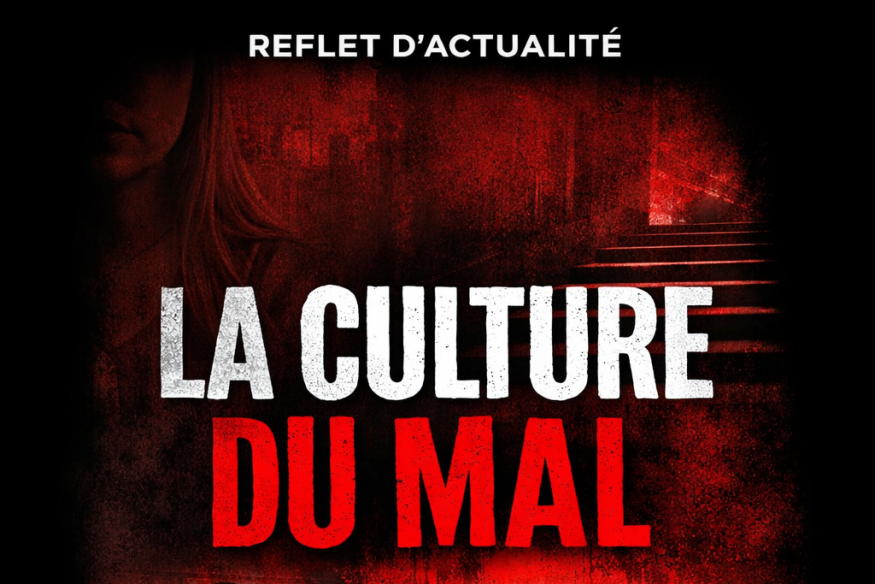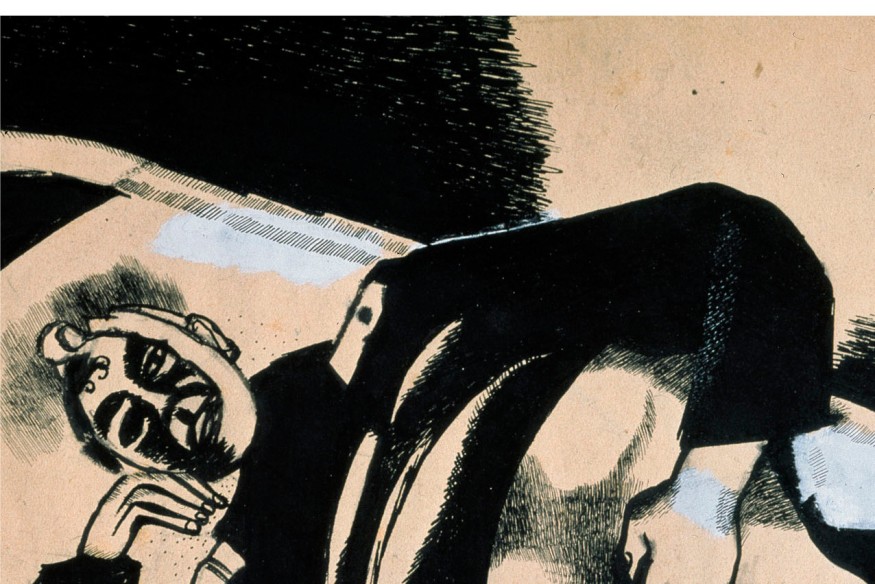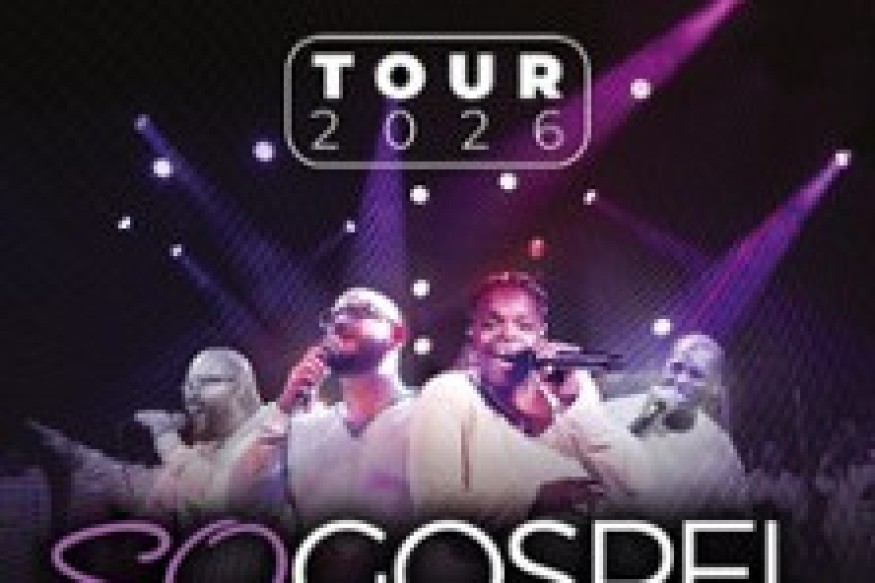24 novembre 2020 - 2488 vues
24 novembre 2020 - 2488 vues
LIBÉREZ LA LIBERTÉ
Nous traversons une situation très particulière qui risque de durer autant de temps qu’a duré la Grippe Espagnole, il y a juste un siècle. Laquelle grippe a emporté plus de 50 millions de personnes dans le monde en l’espace de deux ans, entre 1918 et 1920.
Aujourd’hui, la pandémie suscite beaucoup d’inquiétudes et déstabilise nos sociétés.
Dans notre pays, chaque jour, des directives contraignantes, des informations contradictoires, des décisions prises dans l’urgence viennent effacer ou accentuer les directives, les informations et les décisions de la veille.
Et chaque jour amène son sujet polémique.
On parle pas mal, en ce moment, des déclarations du ministre français de l’Intérieur, lequel interdit les rassemblements religieux devant les lieux de culte. À plus forte raison interdit-il les célébrations du même type dans les églises.
Pour lui, et sans doute pour plusieurs de ses collègues, la culture, le loisir, le sport, la spiritualité ne sont pas essentiels à la vie des citoyens puisque ces secteurs sont frappés d’interdits.
Dès lors, il serait intéressant de savoir ce qui est essentiel, et ce qui ne l’est pas. Et d’expliquer également ce qui est vraiment « de première nécessité » et ce qui est accessoire.
Or, disons-le sans ambages avant qu’il soit interdit de le dire :
L’État outrepasse son pouvoir et ses compétences lorsqu’il prétend pouvoir dire, aux citoyens que nous sommes, ce qui est essentiel pour nous, et ce qui ne l’est pas.
Osons le répéter : il y a quelque chose d’infantilisant pour la population lorsqu’un État liste les choses à vivre et celles qui doivent être oubliées, pour un temps ou pour longtemps.
Derrière cette position se cache à peine une idéologie qui part du principe que la vie, c’est la vie matérielle. Du coup, la spiritualité est une option acceptée, une opinion tolérée, mais non essentielle.
Certes, nous sommes en guerre contre un virus, et il faut agir. Peut-être même par décret ! Mais les prescriptions sont-elles seulement sanitaires ou un tantinet autoritaires ? N’y a-t-il pas exploitation des circonstances pour mettre en place un pouvoir directif ? Sommes-nous toujours dans un pays libre, ou dans une colonie ?
Par ailleurs, au nom de la précaution sanitaire, n’est-on pas en train de tuer plus de gens que le virus ?
Peut-être que les morts ne sont pas tout à faire les mêmes, mais tuer les raisons d’être, tuer le petit commerce, tuer les espérances, tuer les horizons, tuer les relations humaines, tuer les liens intergénérationnels, n’est-ce pas tuer ?
Le paiement sans contact, c’est pratique, mais la vie sans contact, c’est mortel !
L’augmentation des faillites, du nombre de chômeurs et particulièrement l’explosion de la pauvreté dans une société comme la nôtre, n’est-ce pas aussi une hécatombe ?
Bien sûr qu’il faut ralentir et neutraliser la pandémie, mais la médecine employée par les politiques n’est-elle pas pire que le mal combattu ?
Quand, pour soigner les gens, les savants d’hier faisaient des saignées qui tuaient plus rapidement que les maladies, ne se trompaient-ils pas de façon magistrale ? On le sait aujourd’hui, le remède était pire que le mal.
Il n’est pas impossible que l’erreur se répète.
Lorsqu’une centaine de maires alertent le Président sur la situation de pauvreté catastrophique des populations ; lorsque les associations humanitaires signalent la détresse rencontrées partout ; lorsque les personnels soignants annoncent l’émergence de nouvelles pathologies nées de l’isolement et du manque de contacts physiques ; lorsque les psychiatres annoncent une flambée de dépressions et d’ humeurs suicidaires…, peut-on encore parler d’effets positifs des gestes barrières ?
« Oui, mais, la vie est importante et c’est pour elle que nous nous battons ! » semble dire les autorités politiques.
Sans doute !
Cependant, un gouvernement ne peut pas prétendre défendre la vie, justifiant ainsi des restrictions de libertés, et en même temps, allonger le délai qui permet l’avortement d’un enfant à naître.
Quelque part, on a bel et bien choisi la vie à défendre, laquelle semble furieusement économique, pour ne pas dire matérialiste.
Faut-il opposer santé et liberté comme si l’une était l’ennemie de l’autre ?
Ce serait une erreur.
C’est pourquoi il ne faut pas, dans ces circonstances, oublier de défendre la liberté.
Liberté ! mais laquelle ?
Même dans ce domaine, il peut y avoir déviance.
En effet, la tendance est toujours de voir midi à sa porte.
Tout le monde semble demander et réclamer la liberté, mais le libraire demande la liberté de vendre ses livres,
le restaurateur réclame la liberté d’ouvrir ses tables,
le marchand de jouets revendique la possibilité d’écouler ses joujoux
et même les catholiques implorent la liberté d’aller à la messe.
Tout cela semble juste, mais chacun à tendance à réclamer la liberté qui l’intéresse, alors que le vrai combat - et la parole juste - serait de vouloir et d’espérer la liberté pour la liberté. Sinon, les revendications risquent d’être partisanes.
Il est possible de parodier l’apôtre Paul : « Amis, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre égoïstement ! »
On parle de laïcité comme une valeur de la république et de la démocratie, mais en fait, ce qui nous est présenté aujourd’hui, c’est le laïcisme : l’Etat a le monopole de l’espace publique et la religion doit être confinée dans la sphère privée. Il n’est pas impossible que cette idée, fausse, soit devenue une loi à laquelle se plie même les instances religieuses.
Les lois sont acceptables si elles défendent des principes qui nous sont supérieurs, et non qui protègent ou défendent des intérêts particuliers, y compris l’idéologie du pouvoir en place.
On peut être un parfait citoyen sans être pour autant un mouton qui se résigne à obéir parce qu’un gouvernement l’ordonne.
Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas lutter contre la maladie, mais la fin ne justifie pas les moyens. Il faut avoir un sens des proportions des mesures que l’on prend sans porter atteinte de manière excessive aux libertés fondamentales énoncées dans la Déclaration des Droits de l’Homme.
Bien sûr, il ne s’agit pas pour chacun, d’interpréter la loi et de la réduire à sa compréhension pour ensuite faire ce qu’on juge personnellement bien de faire. Il faut accepter d’être, au moins généralement, légaliste et respectueux des lois. Sinon, de la démocratie au despotisme, on en vient à la démocrature ou à la distocratie ; c’est-à-dire une dictature qui se fait passer pour une démocratie. Ce qui risque d’arriver alors, c’est une montée de colères incontrôlables qui prendra le chemin de l’anarchie.
Éric Denimal